Mauvais bilan pour l’euro
Par rapport à mars 2018, l’euro a perdu 10 % de sa valeur par rapport au dollar en 1 an : 1,25 $ = 1 € à l’époque contre 1,12 $ = 1 €.
Selon la synthèse « Les 20 ans de l’euro : quel bilan ? » de Natixis, « la création de l’euro a eu les coûts macroéconomiques attendus pour les pays de la Zone euro :
- avec la disparition des politiques monétaires nationales, et l’absence de budget fédéral, l’incapacité à corriger les chocs et les structures asymétriques, d’où l’hétérogénéité croissante de la Zone euro ;
- le coût excessif des dévaluations internes qui empêche qu’elles soient utilisées pour corriger les handicaps de compétitivité dus aux écarts entre les fonctionnements des marchés du travail.
Mais, la création de l’euro n’a pas eu les avantages microéconomiques attendus, liés à la disparition du risque de change :
- depuis 2010, la mobilité des capitaux entre les pays de la Zone euro a disparu, et l’épargne ne finance plus les investissements efficaces ;
- le marché unique n’a pas développé les échanges commerciaux entre les pays ni permis l’apparition de grandes entreprises dans les secteurs stratégiques. Au total, la création de la Zone euro a eu les coûts macroéconomiques prévisibles, mais n’a pas apporté les progrès microéconomiques espérés. »
L’échec de l’euro est un des grands responsables de l’endettement public et privé et de l’appauvrissement de la population en gilets jaunes. Le QE ne pouvant plus relancer la production, l’Union soviétique européenne impose donc des politiques budgétaires de hausse des impôts, de baisse d’investissement public et de dévaluation interne par une diminution générale des revenus (entraînant mécaniquement celle de la demande interne). Les comptes extérieurs de certains pays déficitaires ont néanmoins été redressés grâce à cette politique, mais à quel prix ? L’Euroland détient aujourd’hui le taux de croissance économique le plus faible du monde et un taux de chômage élevé pour les moins de 25 ans en Grèce (36,6 % en septembre 2018), en Espagne (34,1 %), en Italie (31,6 %) et en France (24 %). Chiffres officiels toujours minimisés à mettre en parallèle avec ceux des États-Unis (12,8 %) ou de la Grande-Bretagne (15,3 %). La République tchèque (4,9 %), l’Allemagne (6,1 %) et les Pays-Bas (6,9 %) s’en sortent mieux avec des taux de chômage des moins de 25 ans les moins élevés de l’UE.
Le 11 février 2019, l’européiste Wall Street Journal nommait tristement un article « L’incroyable rétrécissement de l’Europe », en signalant qu’entre 2009 et 2017 la croissance a atteint 139% en Chine, 96% en Inde, 34% aux États-Unis et -2% dans l’UE, selon la Banque mondiale. En effet, après 20 ans d’existence, le bilan économique de l’euro est largement négatif. Tous les dysfonctionnements annoncés par les économistes qui doutaient des avancées fédérales avant la création de l’euro se sont réalisés :
- « mouvements des capitaux en direction des zones les plus attractives sur le plan fiscal et sur le plan des coûts de production et de la tradition industrielle [vampirisation des capitaux du Sud vers le Nord],
- monnaie sous-évaluée pour certains pays (de 15 % pour l’Allemagne selon le FMI) et surévaluée pour d’autres (de 12 % pour la France),
- déséquilibres des paiements courants (en vingt ans l’Allemagne est passée de l’équilibre à un excédent de 8 % du PIB),
- désindustrialisation de certains pays (production industrielle : -10 % en France depuis 2000, + 35 % en Allemagne),
- émigration des jeunes du Sud vers le Nord ».
« Pour l’instant, la zone euro est un échec » selon Patrick Artus (5 septembre 2018), le directeur de la recherche et des études de la banque Natixis, officiellement l’une des plus prestigieuses banques françaises. Défenseur de l’euro, il explique malgré tous les trois principaux problèmes de la devise selon lui :
- la mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro n’existe plus ;
- les échanges commerciaux entre les pays de la zone euro ne progressent plus ;
- les entreprises européennes des nouvelles technologies ne se sont pas développées malgré le marché unique.
De plus, l’absence d’un marché unifié de la dette publique « condamne l’euro à rester une monnaie de réserve de second rang derrière le dollar » toujours selon la banque française. Si sur 20 ans, la monnaie a été plus stable que la devise américaine, elle est toujours restée derrière le patron dollar en tant que devise internationale. À ce propos, une source à la Commission européenne assure que l’euro n’a aucune velléité stratégique, soit par tactique soit par soumission réflexive : « Nous ne voulons pas remplacer le dollar, mais nous voulons qu’un choix existe entre les deux monnaies » selon l’individu. L’absence de volonté de puissance aura raison de Bruxelles.

Les conclusions du récent rapport allemand émis par le Centre de Politique Européenne (CEP) ont également été très médiatisées récemment (« 20 ans d’euro: perdants et gagnants, une enquête empirique », février 2019) : l’euro aurait depuis sa création « transféré à certains pays ce qu’elle a apporté à d’autres ». En résumé, la France et l’Italie sont les grands perdants de la monnaie zéropéenne, tandis que ces plus grands bénéficiaires sont l’Allemagne et les Pays-Bas. Chaque Français aurait perdu 56 996 € sur la période 1999-2017 et chaque Italien 73 605 €, tandis que les Allemands auraient dégagé 23 116 €/habitant et les Néerlandais 21 003 €/habitant selon cette étude.
Le bilan global de la zone euro est négatif selon le CEP, notamment à cause d’un point particulier ayant noirci le tableau économique : l’impossibilité de la dévaluation monétaire pour soutenir la compétitivité de pays tels que la France et l’Italie, notamment dans leurs exportations. Le think tank allemand époustouflera les plus sceptiques avec la recommandation de l’année pour la France : engager des améliorations structurelles et suivre « avec rigueur la voie de la réforme du président Macron ».
Vu que l’information a été abondement relayée par tout eurosceptique ou europhobe qui se respecte, l’étude a été critiquée par la presstituée antisociale de toute part pour défendre le saint euro. Les médias eurolâtres ont en mis en avant la difficulté de comparaison entre la France et des pays hors euro comme le Royaume-Uni et l’Australie, la temporalité assez courte de l’étude, ainsi que son caractère purement empirique. Certains économistes soutiennent même que si la même étude était reconduite d’ici quelques années, la France pourra être parmi les « winners » de l’euro, car quand la Chine n’aura plus besoin des technologies allemandes « elle importera peut-être beaucoup de produits de luxe et de services ». C’est vraiment à se rouler par terre des fois.
L’étude du CEP est évidemment critiquable par ses méthodes de calcul économétriques, qui s’avèrent souvent hors-sol et basées sur des postulats philosophiques erronés, mais embellis par un champ lexical valorisant (consommateur rationnel, concurrence pure et parfaite, avantage comparatif, etc.). L’euro est un échec aberrant, notamment pour l’Europe du sud, facilement mesurable au niveau des pertes enregistrées par des pays tels que l’Italie ou la France. Nul besoin de l’étude du CEP pour le démontrer, car ses points majeurs sur les désavantages de l’euro rejoignent les analyses de l’économiste Jacques Sapir, de l’Union Populaire Républicaine (UPR) ou encore de l’extrême majorité des prix Nobel d’économie en activité selon l’économiste américain surcoté Joseph Stiglitz (lui-même Nobel d’économie en 2001 et ancien économiste en chef à la Banque mondiale), pour ne citer qu’eux.
Selon Jean Quatremer dans son dernier livre « Il faut achever l’euro » (Calmann-Lévy, 2018), cette monnaie sans État disparaîtra au travers d’un krach dévastateur s’il n’y a pas de saut fédéral dans l’UE. On commence à comprendre le projet. Ce journaliste spécialisé dans les questions européennes (Prix Richelieu en 2010 et chevalier des Arts et des Lettres en 2013), soutien d’Emmanuel Macron et mécène d’En marche, relève quatre problématiques principales à l’UE :
« – A l’opposé de l’élan enthousiaste vers « l’Europe », on assiste à des manœuvres confuses, lourdes d’arrière-pensées électorales et de calculs personnels, aboutissant à des compromis bancals entre des intérêts divergents. Ce n’est pas une découverte, mais une confirmation solidement étayée.
– Un certain nombre de dirigeants ne comprennent pas le sens des décisions qu’ils prennent – tout particulièrement dans le domaine monétaire – faute de connaissances théoriques. Le « pragmatisme » a fait des ravages et continue d’en faire.
– Souvent ignares, les dirigeants français se signalent par la trahison constante des promesses qu’ils ont faites à leurs électeurs. Jacques Chirac qui voulait réduire la fracture sociale se rallie à l’austérité, Lionel Jospin signe le traité d’Amsterdam et tous s’alignent sur Berlin…
– L’Allemagne défend ses intérêts nationaux confondus avec les dogmes de sa classe dirigeante – monnaie forte, lutte contre l’inflation, équilibre budgétaire – et les fait prévaloir en soumettant de gré ou de force ses partenaires. »
Jean Quatremer conclut son livre sans détour : nous sommes soumis à « l’imperium allemand » dans une « Europe allemande ». Mieux vaut tard que jamais… sauf en économie.
Target 2 : même les Allemands, vainqueurs de l’euro, préparent la fin de la partie
Un autre problème et non des moindres : les Target 2. Cette notion traduit, entre autres, l’état des balances des paiements courants intra-zone euro. Les soldes du système de paiements de la zone euro Target 2 ont doublé depuis 2012 ; le solde de la balance de l’Allemagne sur les autres pays membres étant largement excédentaire [cf. notre article sur l’éclatement de la bulle obligataire et l’euro]. La Bundesbank (la banque centrale allemande) prête plus de 900 Mds € aux banques centrales des pays du Sud. À l’instar de l’assouplissement quantitatif (QE), le système Target est une redistribution forcée entre les pays de la zone euro. Et ce partage, les Allemands n’en sont pas friands.
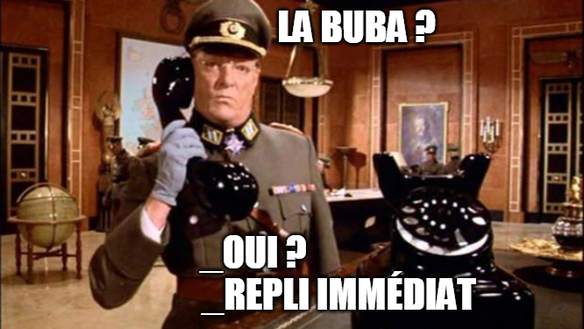
Selon le très sérieux magazine hebdomadaire d’affaires allemand Wirtschafswoche, la fin implicite de l’euro fait aujourd’hui partie du discours du CDU/CSU d’Angela Merkel, soit la force politique la plus puissante d’Allemagne. Rien que cela. Au pouvoir à Berlin depuis treize ans, le Conseil économique de la CDU (Wirtschaftsrat) réclame désormais à son tour que soient « collatéralisées » les nouvelles dettes Target. En effet, l’Allemagne finance actuellement via des prêts non garantis, sans intérêts et non remboursables, des pays à la solvabilité douteuse (l’Italie étant visée implicitement). La Bundesbank ne peut pas exiger le remboursement des créances accumulées jusqu’à présent (financièrement impossible) et devra probablement en supporter au moins une partie. Inacceptable pour ce pays excédentaire.
Le professeur Clemens Fuest, n° 1 du think tank allemand IFO Institute, a soutenu que la crise européenne risque fort de s’aggraver, car la BCE devra couper les lignes de crédit Target 2 accordées à la Banque d’Italie si Rome défie Bruxelles. Selon lui, l’Allemagne ne récupèrera jamais les 923 Mds € de crédits Target 2 disséminés partout dans l’Euroland et qui sont dus à la Bundesbank. Berlin met donc en place une voie de secours pour une sortie de l’euro et pour rendre négociable le paiement des soldes Target 2. La Bundesbank considère ses créances envers les banques centrales du sud de l’Europe comme des crédits toxiques. Les créances étant immédiatement exigibles en cas d’exit, ces mouvements outre-Rhin ne sont pas souhaitables pour, au hasard, l’actuel gouvernement italien. Les plus grands banquiers centraux allemands (Helmut Schlesinger, Axel Weber, Jürgen Stark ou Jens Weidmann) ont dénoncé chacun leur tour le système Target 2 par des alertes voire des démissions de leurs postes.
Le 21 mai 2018, 154 professeurs d’économie outre-Rhin ont également appelé au rejet du plan Macron de réforme de la zone euro et à l’introduction d’une « procédure ordonnée de sortie de l’euro » dans les traités européens. En effet, il est actuellement impossible pour un État de sortir juridiquement de l’euro sans sortir de l’UE en même temps. Cette clause propose donc de bien distinguer les deux choix. Fait notable : cette tribune a été publiée par le quotidien allemand de référence du patronat et des élites allemandes, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. De quoi briser à jamais la sacro-sainte irréversibilité de l’euro.

Berlin est même carrément jugé en position de faiblesse par rapport aux autres pays de la zone selon Natixis (note du 13 février 2019) :
- « L’explosion de l’euro aurait des conséquences dramatiques pour l’Allemagne, comme l’explosion du Système monétaire européen en 1992 ; l’Allemagne est donc forcée d’accepter tous les mécanismes qui protègent l’intégrité de la Zone euro en cas de crise;
- la régionalisation croissante des échanges, avec le retour des productions au voisinage des acheteurs finaux des biens, conduit à ce que l’Allemagne ait besoin d’un marché intérieur dynamique de la Zone euro ; l’Allemagne doit donc contribuer à soutenir la demande intérieure de la Zone euro, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui;
- les autres pays de la Zone euro ont une très forte dette, sous diverses formes (détention en Allemagne de dette publique des entreprises, des banques des autres pays, balances Target 2) vis-à-vis de l’Allemagne ; l’Allemagne est donc contrainte de collaborer au maintien de la solvabilité des emprunteurs des autres pays de la Zone euro. »
À noter que l’excès d’épargne des Allemands est déjà prêté majoritairement en dehors de la zone euro. Ils préfèrent favoriser les investissements chez les Anglo-saxons, au Brésil, en Inde, en Chine et en somme partout où il n’y a pas l’euro, car le risque de redénomination (actifs menacés par une conversion dans une nouvelle devise sans possibilité de couverture) y est moins présent. Décidément, l’exit provoque l’épouvante au pays d’Angela. Mais pragmatisme oblige, tout le monde s’y prépare, sauf en Macronie.
L’Italie, la nouvelle Grèce sur liste noire allemande

Rome est la principale épine dans la botte allemande. La capacité de nuisance de l’Italie, les Target 2 et le QE inquiètent. Le secteur bancaire italien étant sous perfusion de liquidités (QE), son secteur bancaire va subir de plein fouet la nouvelle politique de la BCE (fin du QE, taux d’intérêt relevés), qu’elle se concrétise ou non. L’Italie, qui profitait bien de la manne monétaire européenne, risque maintenant d’avoir quelques problèmes de financement. La remise en question des programmes de Targeted longer-term refinancing operations (TLTRO), les prêts à long terme (trois ans) accordés aux banques par la BCE, pourrait particulièrement être problématique pour le pays. La BCE devra inévitablement octroyer de nouveaux financements à taux préférentiels pour éviter le choc. De plus, si elle n’apporte pas sa garantie sur des taux identiques à tous les pays de l’UE, l’Euroland pourrait en pâtir sérieusement. Effectivement, l’écart des taux d’intérêt des emprunts entre les pays de la zone euro n’a cessé de s’agrandir depuis 2008 : les taux italiens, espagnols et portugais ont explosé, comme pour prévenir le risque.
Attendez, pardon on vient de me dire dans l’oreillette que Draghi Malefoy a annoncé début mars 2019 qu’il allait recommencer à octroyer des prêts à long terme bon marché (TLTRO) aux banques européennes à cause de la baisse cumulée de la croissance (1,1 % en 2019 au lieu des 1,7 % prévu initialement par la BCE) et de l’inflation (1,2 % en 2019 contre 1,6 % prévu). La BCE nous donne donc rendez-vous entre septembre prochain et mars 2021 pour que les banques puissent « prêter davantage aux entreprises et aux ménages », mais cette nouvelle vague de prêts géants et bon marché aux banques ne sera pas plus efficace qu’avant.

Depuis plusieurs années déjà, le « monde de la finance », selon l’expression de Flamby, se crispe sur l’explosion potentielle de la dette italienne et un possible défaut souverain. La Commission européenne a également mis la pression à l’Italie en annonçant recommander au Conseil de l’UE d’initier une procédure d’infraction pour dette publique trop excessive (132 % du PIB). L’amende pouvant aller jusqu’à 0,2 % du PIB du pays, soit 3,4 Mds € (Ruptures n° 80, 28 novembre 2018, p.4).
JPMorgan, la plus grande banque des États-Unis et une des plus importantes du monde, avait notamment déclaré en juin dernier qu’une sortie de l’euro pourrait être intéressante pour Rome. Rétrospectivement, une étude de la non moins célèbre Merryll Lynch (détenue par Bank of America) concluait déjà en 2012 que l’Italie serait avantagée par l’abandon de l’euro (à l’instar de la Grèce et l’Irlande selon eux). La même année également, le grand reporter britannique Ambrose Evans-Pritchard jugeait dans le Daily Telegraph que le principal handicap économique de l’Italie était la monnaie unique. Une thèse suivie par Andrew Robert, de la Royal Bank of Scotland (une des plus vieilles banques britanniques), qui défendait qu’une sortie de l’euro soit bénéfique pour l’Italie au vu de ses exportations et de son excédent primaire. La banque Natixis signale elle a contrario qu’aujourd’hui « le niveau très élevé des dettes extérieures en euros rend en effet la sortie de l’euro et la dépréciation du taux de change extrêmement coûteuses et dangereuses ». L’Italie devra donc se résoudre à geler des salaires pour améliorer la compétitivité, comme en Espagne depuis la crise, selon la banque française.
L’homme d’affaires et d’État italien Silvio Berlusconi donnait déjà le ton en 2017 sur l’introduction d’une monnaie parallèle dans le pays ; autant dire une sortie implicite de l’euro. Une mesure qui est toujours dans la tête de la Chancellerie germanique, car elle « plongerait l’Allemagne dans l’abîme, et après tout, c’est le pays qui a le plus investi dans le système de l’euro » selon le président du Comité budgétaire du Parlement italien, Claudio Borghi. Sans mutualisation des risques financiers, la stabilité de la zone restera précaire et le risque individuel de chaque pays face à une crise se répercutera dans les autres pays au vu de l’imbrication des systèmes financiers de la zone.
Alors que le financement du pays sur les marchés financiers ne posait pas de problème jusque-là, de nouveaux paramètres rentrent aujourd’hui en compte. La principale garantie de l’État italien réside dans sa dette souveraine largement détenue par les Italiens eux-mêmes ; ils détiennent 66,3% de leur dette à la mi-2018 contre 47% pour la France. Les résidents étant par définition plus fidèles dans leur détention d’actifs financiers nationaux que des investisseurs étrangers, c’est un bon point en cas de crise. Mais les ménages italiens commencent à se désengager de la dette de leur État depuis quelques années déjà. De plus, le patrimoine des ménages en Italie très élevés par rapport au reste de l’Europe (supérieur aux ménages allemands) s’avère être en réalité principalement un patrimoine immobilier très cher au m² par le phénomène de rente foncière, en plus d’être plutôt rare et de faible qualité. L’Italie n’est donc pas à l’abri d’une crise financière en raison du besoin de refinancement de sa dette publique (240 Md€ pour 2019 selon Natixis), couplé à un risque de désengagement rapide des investisseurs étrangers.
On l’a compris, l’Italexit est risqué, mais a de beaux jours devant lui. Et ce, même si le vice-premier ministre italien et n° 1 du Mouvement Cinq Étoiles (M5S), Luigi di Maio, a abandonné sa position d’un référendum sur l’euro et sur la sortie de Rome de l’UE dès août 2018. Un peu comme l’avait fait le Premier ministre grec Aléxis Tsípras. Nous pouvons toujours spéculer sur un exit préparé en douce à défaut d’une « syrization », mais cette dernière tendance semble tout de même en bonne voie ; le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini ayant également changé de discours dès le début du mois de septembre 2018 en promettant de « respecter les contraintes européennes » (Ruptures n° 78, 26 septembre 2018, p.4). Luigi di Maio et Matteo Salvini continuent néanmoins de taquiner Bruxelles avec des annonces remettant en cause l’indépendance de la Banque d’Italie, sachant qu’une banque centrale non contrôlée par l’État (donc privée) est un dogme clef de l’union monétaire européenne et du système financier international en général.
Nous verrons bien comment tout ce beau monde réagira en plein krach, quand il faudra choisir entre sauver son pays ou sauver (encore) l’euro.
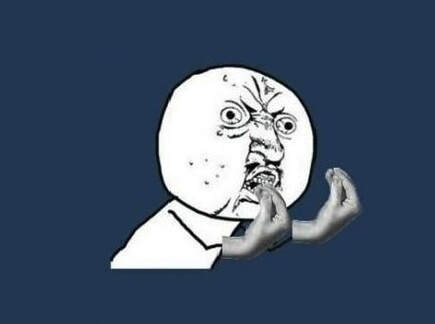
Franck Pengam


